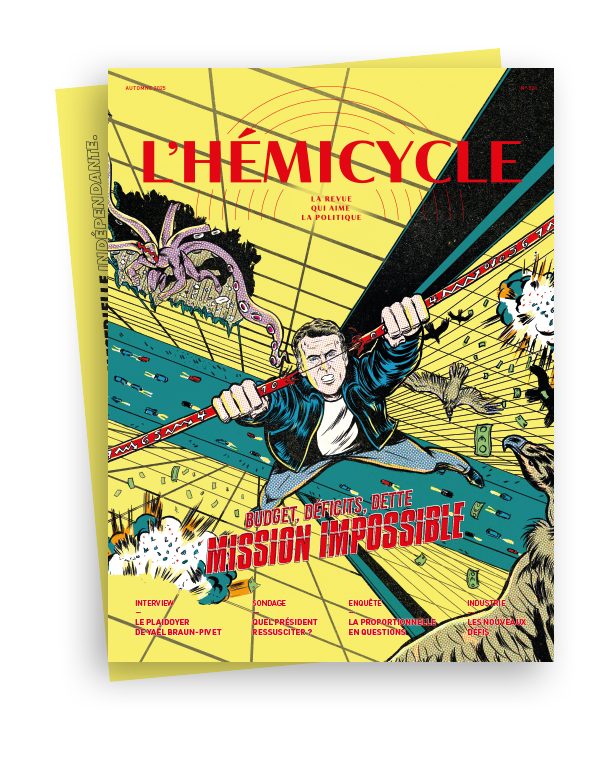L’inclusion avance, les chiffres s’améliorent, les dispositifs se consolident, fruits d’un engagement commun des employeurs publics, privés et des acteurs spécialisés. Mais pour que l’emploi des personnes en situation de handicap continue de progresser, un cap important reste à franchir : changer le regard de la société, en particulier sur les handicaps invisibles, encore trop méconnus et souvent mal compris.

Vingt ans après la loi du 11 février 2005, qui a fait du handicap un enjeu national, les lignes ont bougé. Le nombre de personnes handicapées occupant un emploi a doublé en deux décennies, pour dépasser 1,3 million en 2024. Leur part au sein de la population active atteint aujourd’hui 7,5 %, deux fois plus qu’en 2002.
Ces chiffres traduisent les progrès accomplis grâce à une mobilisation constante des employeurs publics et privés, soutenus notamment par des acteurs clés comme l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). En vingt ans, ces organismes ont accompagné le recrutement de plus de 1,5 million de personnes en situation de handicap, développant des dispositifs adaptés et favorisant une meilleure inclusion dans le monde professionnel.
Mais les défis restent immenses : le taux d’emploi des personnes handicapées progresse trop lentement – il est de 41 % contre 69 % pour la population générale. De même, plus de la moitié des personnes handicapées sont en situation de chômage de longue durée. Enfin, en 2023, selon la Dares, 30 % des entreprises soumises à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap n’en accueillaient… aucun.
Par ailleurs, certains handicaps restent plus difficiles à identifier et à intégrer. C’est le cas des handicaps invisibles, notamment les troubles psychiques, qui concernent un actif sur cinq au cours de sa vie.
Handicaps invisibles,
un défi oublié ?
Dépression, troubles anxieux, bipolarité, trouble du spectre autistique, trouble du déficit de l’attention… ces réalités, souvent cachées, peuvent être invalidantes et restent mal comprises. En France, si 80 % des handicaps déclarés sont invisibles, seuls 2 à 3 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi disposent d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) liée à un trouble psychique. Un tel décalage dit la peur d’être incompris ou disqualifié dans sa trajectoire professionnelle.
Car le handicap psychique est sans aucun doute le plus stigmatisé de tous. Il est, de loin, la situation de handicap la moins acceptée : d’après un récent baromètre de l’Agefiph2, plus d’un tiers des salariés (34 %) déclarent ne pas être prêts à travailler avec une personne en situation de handicap psychique, et seuls 16 % des dirigeants jugent son intégration facile.
Contrairement aux handicaps visibles, les troubles psychiques peuvent être intermittents, fluctuants, ou confondus avec des difficultés passagères. Ce flou nourrit incompréhension et isolement. Nombre de salariés choisissent de vivre leur pathologie dans le silence, sans solliciter d’aménagement ni d’accompagnement spécifique.
La RQTH, pourtant conçue pour ouvrir des droits – aménagements d’horaires, adaptation des postes, accompagnement médico-social –, reste encore mal connue ou perçue. Et le recours à un médecin du travail, à un référent handicap ou à des acteurs spécialisés comme Cap emploi, l’Agefiph, ou le FIPHFP demeure insuffisant.
Relancée en 2023, la stratégie nationale pour la santé mentale encourage justement un changement de regard et une meilleure articulation entre soin, emploi et inclusion sociale. Ce virage est engagé, mais il nécessite encore de libérer la parole, de faire évoluer les représentations et de renforcer les dispositifs existants.
« Oui, je suis un malade mental »
Le 26 mars 2025, Nicolas Demorand, le présentateur de la matinale de France Inter, la plus suivie de France (près de cinq millions d’auditeurs), lève un tabou à l’antenne : « Oui, je suis un malade mental. C’est cru, mais je ne veux plus le cacher ni ME cacher », explique-t-il sans détour. Un mois plus tard, dans l’émission Quotidien, sur TMC, il évoque ouvertement sa bipolarité de type 2, diagnostiquée huit ans plus tôt, après des années de souffrance silencieuse. Il raconte ses hospitalisations, ses traitements quotidiens, ses longues phases dépressives et ses épisodes maniaques, qui « carbonisent le cerveau ».
Mais il évoque aussi son travail, devenu pour lui un véritable ancrage, presque un « médicament ». Pour Nicolas Demorand, il constitue « un espace où il éprouve des sensations. La radio me tient, elle me porte », raconte-t-il. Sa bipolarité n’était connue que d’une poignée de collègues.
Ce témoignage, rare dans l’espace public, a libéré la parole. Mais il éclaire également les représentations persistantes autour de la maladie mentale. « Ces maladies font peur, sont considérées comme honteuses. […] La souffrance psychique est physique, elle fait mal dans le corps. » Trop souvent, les personnes sont renvoyées à l’idée fausse d’un « malade imaginaire ». Pour Nicolas Demorand, briser ce silence, c’est « casser la stigmatisation ».
Dans le milieu professionnel, les personnes en situation de handicap n’ont pas moins de compétences que leurs collègues : elles manifestent souvent une exigence, une rigueur et une lucidité accrues. C’est le regard social, plus que la maladie elle-même, qui freine leur pleine reconnaissance. « Peut-on croire un journaliste malade mental ? », interroge-t-il dans son livre Intérieur nuit (Éditions Les Arènes, 2025). La réponse est clairement oui, au même titre qu’un journaliste atteint d’un cancer.
Changer le regard collectif
Dans les entreprises, les mentalités évoluent : la santé mentale devient un enjeu central des politiques handicap, à travers la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux et la lutte contre les discriminations. Les employeurs peuvent s’appuyer sur un réseau d’acteurs engagés (Agefiph, FIPHFP, Cap emploi, médecine du travail, associations…), qui proposent formations, sensibilisations, aménagements, cellules d’écoute ou diagnostics.
Mais pour que ces outils portent leurs fruits, un ingrédient reste essentiel : la confiance. De nombreux salariés attendent encore un cadre où leur parole soit entendue et protégée. Renforcer la formation des encadrants, développer les dispositifs, valoriser les témoignages : autant de leviers pour faire du handicap psychique une composante pleinement reconnue de la diversité. « Il faut que la société regarde ces maladies-là avec bienveillance et si possible avec intelligence », conclut Nicolas Demorand.