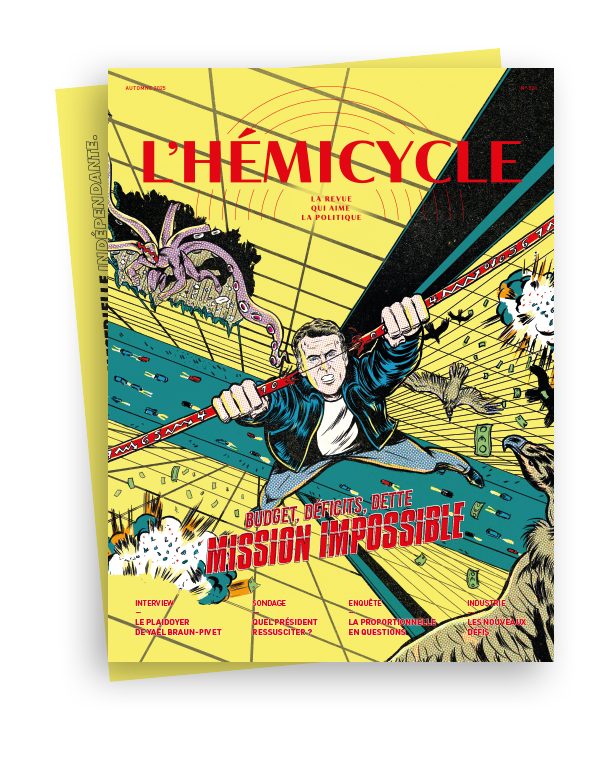Deux décennies après la loi du 11 février 2005, Caroline Dekerle et Marine Neuville, directrices générales l’une de l’Agefiph et l’autre du FIPHFP, dressent le bilan de l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs privé et public. Entre progrès concrets, défis persistants et ambitions pour l’avenir, elles soulignent l’importance d’inscrire l’inclusion au cœur du monde du travail et de la société.
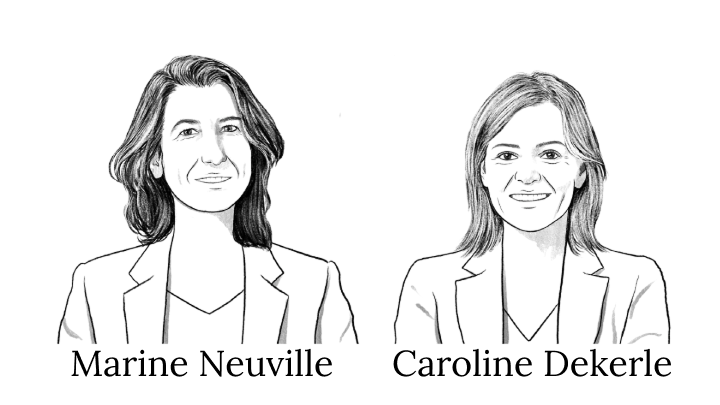
Vingt ans après la loi du 11 février 2005, quel regard portez-vous sur son impact dans le monde du travail ?
Caroline Dekerle La loi de 2005 a été un tournant majeur. Elle a d’abord changé le regard sur le handicap, en posant une définition beaucoup plus large et inclusive. On a encore besoin de libérer la parole et de démystifier : le handicap, ce n’est pas seulement le fauteuil roulant, cela peut être un diabète, une épilepsie ou certaines allergies. Nombre de recruteurs ont encore des idées reçues, et cette loi permet de rappeler que 80 % des handicaps sont invisibles. Compte tenu de cette diversité des situations de handicap, aucun poste n’est par principe incompatible avec le handicap. Le second apport fondamental, c’est l’idée que c’est à l’environnement de travail ou de formation de s’adapter à la personne, et non l’inverse. C’est cette logique, qui irrigue depuis vingt ans les politiques publiques : accessibilité des centres de formation, aménagement des postes en entreprise, et priorité donnée à l’emploi en entreprise ordinaire classique ou adapté (entreprise adaptée, emploi accompagné) avant de recourir à des structures spécialisées comme les Esat.
Marine Neuville Je partage pleinement cette vision. La loi a introduit une conception plus moderne du handicap : il ne s’agit plus seulement de qualifier une caractéristique individuelle, mais d’évaluer les conditions de l’interaction d’une personne avec l’environnement professionnel. Une situation de handicap, c’est avant tout une difficulté dans un contexte donné – d’où l’importance d’un environnement inclusif capable de proposer des aménagements et des solutions de compensation.
Cette loi a aussi marqué un progrès pour la fonction publique avec la création du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées (FIPHFP). En alignant le secteur public sur le privé, elle a instauré une dynamique nouvelle. Vingt ans plus tard, les résultats sont concrets : en 2024, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap atteint 5,93 % dans la fonction publique, soit plus de 600 000 agents. Les administrations se sont structurées avec la désignation de référents handicap et de sous-préfets dédiés au handicap pour accompagner les agents et faire progresser la culture de l’inclusion.
Quels sont les défis à relever ?
C.D. L’emploi, c’est avant tout une rencontre entre une personne et un employeur. En France, l’obligation d’emploi de 6 % est difficile à atteindre sans accompagnement. Les employeurs ne sont pas malveillants, mais souvent démunis : il faut leur expliquer le handicap, le démystifier et montrer l’intérêt d’une politique inclusive, au-delà de l’obligation légale. Les entreprises handi-engagées témoignent de bénéfices tout autres : répondre à un phénomène de métiers en tension en s’ouvrant à de nouveaux talents en situation de handicap à l’égard desquels on pouvait en première intention se sentir freiné et attirer des collaborateurs à la recherche d’un employeur qui porte concrètement des valeurs autour de l’inclusion. Une telle politique a aussi la vertu de préserver son capital humain en appréhendant davantage au travers du handicap les problématiques de maintien dans l’emploi et de prévention des risques de rupture de fédérer un collectif de travail autour d’une thématique qui touche tout le monde et améliorer son dialogue social avec un sujet qui fait consensus.
L’Agefiph accompagne les entreprises de toute taille pour les aider à aller vers davantage d’inclusion : sensibilisation des collectifs de travail, appui à l’élaboration de plans d’action handicap, montée en compétence et outillage des référents handicap, dont la présence est obligatoire depuis 2018 dans les entreprises de plus de 250 salariés.
M.N. Dans la fonction publique, l’un des grands défis, maintenant, c’est l’accessibilité globale, et en particulier numérique. C’est un enjeu fort porté par le FIPHFP, mais il reste encore des marges de progression pour que toutes les applications métiers soient pleinement accessibles aux agents. Aujourd’hui, un employeur public sait aménager un poste pour une personne malentendante ou en fauteuil roulant. En revanche, les handicaps invisibles, comme le trouble du spectre autistique, demandent un accompagnement différent : un encadrement adapté, du job coaching, des aménagements d’horaires… Ce sont des sujets sur lesquels il faut encore avancer.
Quelles sont les différences d’approche entre les secteurs public et privé ?
M.N. Les secteurs public et privé évoluent dans des cadres légaux distincts. Dans la fonction publique, le statut des agents influence le recrutement et l’accompagnement des carrières : les licenciements pour inaptitude y sont rares, ce qui favorise la reconversion et le maintien dans l’emploi. Les enjeux restent similaires, mais les modes d’action diffèrent. L’Agefiph intervient auprès des salariés et demandeurs d’emploi du privé, tandis que le FIPHFP accompagne les employeurs publics. Nous collaborons également sur certains dispositifs cofinancés, comme Cap emploi, les plateformes de prêt de matériel adapté ou l’emploi accompagné.
C.D. Depuis plusieurs années, nous travaillons à rapprocher et à harmoniser nos dispositifs d’aide. Prenons l’exemple d’un apprenti en situation de handicap : s’il commence son parcours dans une entreprise privée qui, pour diverses raisons, ne peut pas poursuivre son engagement, il peut être amené à continuer sa formation auprès d’un employeur public. Or, si les dispositifs d’aide diffèrent entre les deux secteurs, la continuité de son parcours devient incohérente et source de difficultés. C’est pourquoi nous œuvrons à rendre nos soutiens plus cohérents et complémentaires, afin de garantir aux apprentis une égalité de traitement et une véritable fluidité de parcours, quel que soit leur employeur.
Comment favorise-t-on la montée en compétence des personnes en situation de handicap ?
M.N. Notre enjeu est avant tout qualitatif : accompagner les parcours professionnels des agents en situation de handicap, surtout dans des carrières de plus en plus longues. L’objectif est qu’ils puissent bénéficier d’un parcours riche, diversifié et évolutif, comme tout agent public. Plusieurs leviers existent : formation initiale et continue, mais aussi mobilisation des encadrants et des services RH, qui projettent encore trop rarement ces agents sur des postes à plus forte expertise ou à responsabilités. L’autocensure des agents constitue également un frein. Pour y répondre, le FIPHFP soutient le dispositif Handi’Talents, qui accompagne une soixantaine d’agents des trois versants de la fonction publique à travers ateliers de codéveloppement, coaching, tutorat et mentorat, afin de lever ces obstacles et de favoriser mobilité et ambition professionnelle.
C.D. Sur la promotion de carrière, l’Agefiph accompagne les entreprises pour qu’elles se fixent de véritables objectifs, non seulement de recrutement et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi en matière de développement et de progression de carrière. Plus on monte dans la hiérarchie, moins la parole se libère : de nombreux cadres préfèrent ne pas évoquer leur situation de handicap. Les choses évolueront réellement lorsque davantage de rôles modèles rendront visible le fait qu’il est tout à fait possible d’occuper des postes à responsabilités tout en étant en situation de handicap, à l’image de personnalités comme Nicolas Demorand ou Stéphane Séjourné.
Avez-vous des indicateurs chiffrés ?
M.N. Nous avons environ 450 conventions avec des employeurs publics. Nous venons d’adopter un nouveau modèle de convention intégrant des indicateurs de suivi directement liés au plan d’action, avec des objectifs chiffrés tels que le taux de promotion et de formation des personnes en situation de handicap. Ces conventions comportent également des indicateurs relatifs à la mobilité des agents et aux actions destinées à favoriser l’accessibilité numérique au sein des organisations.
C.D. On ne progresse que sur ce que l’on mesure. Les entreprises que nous accompagnons définissent des objectifs et des indicateurs sur différents axes. Le premier concerne la sensibilisation et la formation : que fait-on pour former le personnel et les managers de proximité ? On ne pourra pas maintenir dans l’emploi ou recruter des personnes handicapées si l’ensemble du collectif de travail n’est pas correctement formé. Il est essentiel que cette démarche soit portée par la direction générale et que le référent handicap joue un rôle actif. C’est un véritable binôme, qui assure la cohérence et le suivi de ces actions. En fixant des objectifs simples et atteignables, on procure au référent handicap une feuille de route et à sa direction la capacité de suivre et piloter. Les entreprises nous le disent : lorsqu’un plan d’action structuré est mis en œuvre, leur taux d’emploi progresse. La mesure devient un outil de transformation durable.
Quelles sont vos priorités pour les vingt prochaines années ?
M.N. Mon souhait est qu’un jour, le FIPHFP n’ait plus de raison d’être, que nos dispositifs d’aide spécifiques n’existent plus. L’objectif est que le handicap soit pleinement intégré dans le droit commun, au sein des employeurs publics comme des organismes de formation. Idéalement, il n’y aurait plus besoin de quotas ni de fonds dédiés, car tout ce que nous mettons en place pour le handicap pourrait alors profiter à tous. Le champ du handicap est un véritable moteur d’innovation dans l’organisation du travail.
C.D. Je partage totalement la vision selon laquelle les politiques handicap doivent être naturellement intégrées dans toutes les politiques publiques. Il ne devrait plus exister de ministre du handicap : les ministères du Travail, du Logement, des Transports, etc., devraient tous prendre en compte ces enjeux dans leurs décisions et programmes. À court terme, nous devons travailler tous ensemble à une plus grande articulation des dispositifs existants sur le handicap et à une meilleure lisibilité du « qui fait quoi ? » et ce au bénéfice des personnes et des entreprises. Quant à l’Agefiph, c’est un acteur incontournable dont tout le monde connaît le nom mais qui est trop souvent identifié comme l’organisme du « 6 % » ou comme la structure qui finance des aides ou des projets en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Il est donc indispensable d’améliorer la lisibilité, la qualité, l’efficience et l’impact de nos actions. Pour ce faire, nous entamons dans les prochains jours une démarche pour nous interroger sur nos missions prioritaires, dont l’impact doit pouvoir être mesuré concrètement et dont le caractère différenciant doit attester la complémentarité de l’Agefiph avec d’autres acteurs dits de « droit commun » tels que France Travail.
Il s’agit également de simplifier notre offre, de mieux la « marketer » pour la rendre davantage accessible aux entreprises comme aux personnes et pour commencer à parler « vrai et concret ». Je veux qu’en Pourquoi cinq ? Pourquoi pas une ? phrases simples, on sache dire à quoi sert concrètement l’Agefiph.