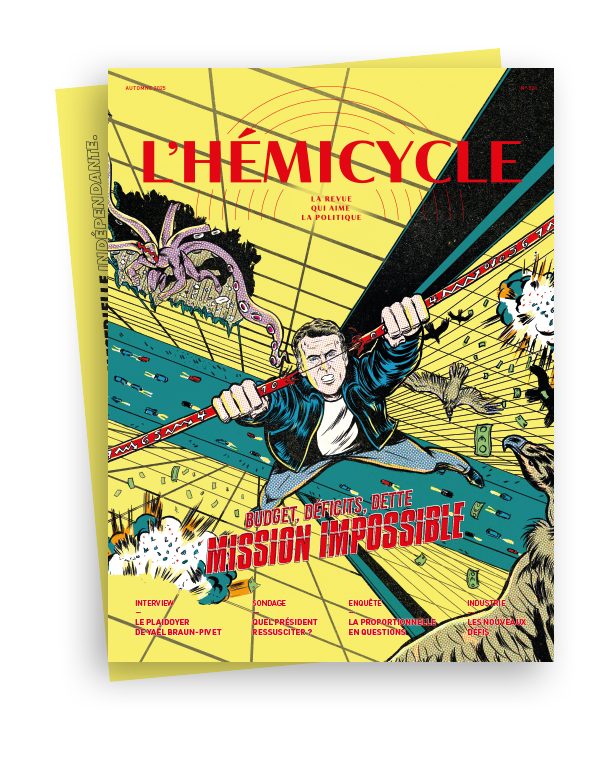Gabriel Petrus est professeur invité à Sciences-Po Paris. Ancien directeur des partenariats internationaux à la Chambre de Commerce Internationale (ICC), il a été Conseiller spécial de la présidence de la République du Brésil entre 2010 et 2013.

Gabriel Petrus est professeur invité à Sciences-Po Paris. Ancien directeur des partenariats internationaux à la Chambre de Commerce Internationale (ICC), il a été Conseiller spécial de la présidence de la République du Brésil entre 2010 et 2013.
Alors qu’Édouard Glissant évoquait dans son Traité du Tout-Monde un « fleuve appelé Atlantique », il ne parlait pas d’un océan qui sépare, mais d’un espace de relation, où les identités se croisent et se réinventent. Cette image poétique prend aujourd’hui une dimension politique : à l’heure où les liens transatlantiques traditionnels perdent de leur vigueur et où les États-Unis se replient sur eux-mêmes, la France gagnerait à tourner son regard — ne serait-ce que légèrement — vers le sud de l’Atlantique.
En portant une attention renouvelée au sud de la ligne équatoriale, la France découvrirait un partenaire capable de contribuer à des solutions concrètes dans plusieurs domaines clés : de la transition énergétique au commerce équitable, en passant par la protection de la biodiversité marine et la réforme des organisations internationales — à un moment où le multilatéralisme doit être réimaginé. Ce partenaire, c’est le Brésil.
Réduire la plus grande démocratie du monde émergent à son appartenance aux BRICS ou à une perception monolithique du « Sud global » ne serait pas seulement une lecture étroite de la complexité géopolitique contemporaine, mais aussi une opportunité manquée. Le Brésil a systématiquement condamné l’invasion russe de l’Ukraine dans les votes de l’ONU, et partage la position des pays de l’Union européenne en affirmant son attachement au droit international et à la souveraineté de l’Ukraine sur l’ensemble de son territoire.
Au-delà du fait que la France partage avec le Brésil sa plus longue frontière terrestre — en Guyane française — les deux pays ont en commun bien plus qu’un voisinage géographique. Ils partagent un attachement profond aux libertés, une vitalité démocratique et une sensibilité culturelle à la fois riche, engagée et ouverte sur le monde. Si, du côté brésilien, La Marseillaise fut chantée par les insurgés paulistes en 1932 comme hymne de liberté et de résistance à l’autoritarisme, du côté français, Henri Salvador, Georges Moustaki ou plus récemment Pauline Croze ont puisé dans la bossa nova brésilienne une musicalité empreinte de douceur, de joie et de mélancolie consciente. D’un rivage à l’autre de l’Atlantique, les liens culturels et politiques tissent une relation plus profonde qu’on ne l’imagine.
Défendre la démocratie dans un monde en recul
À l’heure où la démocratie recule dans bien des régions, du Nord comme du Sud, le Brésil s’impose comme un modèle de résilience institutionnelle parmi les grandes démocraties libérales, porté par un taux de participation élevé et des institutions capables de résister aux pressions internes comme externes. En condamnant récemment un ancien président pour tentative de coup d’État, il tourne la page d’un passé marqué par des dictatures longtemps restées impunies. Cette affirmation de l’État de droit résonne dans un monde où le « Sud global » est trop souvent perçu comme le théâtre des dérives autoritaires.
Face à ce recul démocratique, la France a tout intérêt à s’engager aux côtés de démocraties émergentes comme le Brésil. C’est dans son universalisme qu’elle puise sa force — celle d’une nation guidant non par puissance, mais par principe. « La France n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle parle pour tous », écrivait Malraux. Une alliance transatlantique fondée sur ce socle commun — défense des droits humains, des valeurs républicaines et de la démocratie — prend tout son sens dans un monde en mutation, où la démocratie n’est plus un acquis, mais un combat à renouveler.
La Bioéconomie du développement
Alors que le Brésil se prépare à accueillir la COP30 à Belém, au cœur de la forêt amazonienne, le partenariat franco-brésilien peut s’étendre à des enjeux stratégiques majeurs : la bioéconomie, la protection des océans et la préservation de la biodiversité.
Dans un monde en quête de solutions durables, la bioéconomie offre un terrain d’innovation structurant pour cette relation. Le Brésil, riche de la plus vaste biodiversité tropicale au monde, développe des filières capables de produire des matériaux biosourcés, des bioplastiques, des cosmétiques naturels et des biofertilisants à partir de ressources forestières. La France, forte de son expertise industrielle et de ses territoires ultramarins, peut accompagner cette transition en investissant dans des chaînes de valeur durables et en favorisant le transfert de technologies. Ensemble, les deux pays peuvent bâtir une économie post-fossile fondée sur la valorisation des ressources naturelles, la création d’emplois verts et la préservation des écosystèmes — une alliance écologique qui dépasse les discours pour incarner une nouvelle diplomatie du vivant.
Du commerce à la défense
L’accord entre l’Union européenne et le Mercosur devient une opportunité stratégique pour la France. Dans un contexte marqué par le repli protectionniste des États-Unis, il renforcerait la capacité des entreprises françaises à exporter, à préserver des emplois et à diversifier leurs marchés. Face à la fermeture progressive du marché nord-américain, la France ne peut se contenter de réagir : elle doit s’ouvrir à de nouveaux espaces économiques pour préserver son autonomie stratégique et stimuler sa compétitivité. Un compromis semble désormais à portée, grâce aux clauses de sauvegarde qui protégeront l’agriculture française, tout en facilitant l’implantation de filiales françaises dans les pays du Mercosur. Ensemble, l’UE et le Mercosur pourraient former la plus vaste zone de libre-échange du monde, avec plus de 700 millions de consommateurs — faisant du commerce international un levier de redressement économique pour la France.
Dans le domaine de la défense, la coopération franco-brésilienne franchit un cap stratégique. Naval Group joue un rôle clé dans l’intégration de systèmes critiques hors propulsion nucléaire, pour un montant total de 528,4 millions d’euros. Ce partenariat dote le Brésil de la capacité de propulsion nucléaire, l’intégrant au cercle restreint des nations maîtrisant cette technologie. Il renforce sa souveraineté maritime sur plus de 8 000 km de côtes, tout en consolidant une filière industrielle bilatérale à haute valeur ajoutée.
Une alliance à réinventer
Le Brésil est bien plus qu’un partenaire commercial ou un membre des BRICS. C’est une démocratie stable, un acteur du multilatéralisme, et un allié stratégique pour la France dans un monde en recomposition. À l’heure où les équilibres géopolitiques se déplacent et où les démocraties doivent se soutenir mutuellement, il est temps d’élargir notre vision de l’alliance transatlantique — en intégrant pleinement le Sud de l’Atlantique, là où se joue une part essentielle du futur : écologique, économique et démocratique.