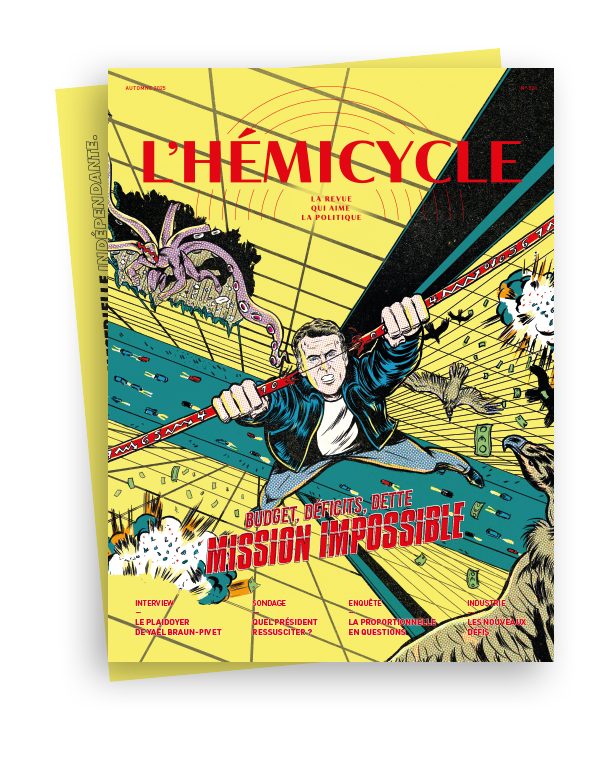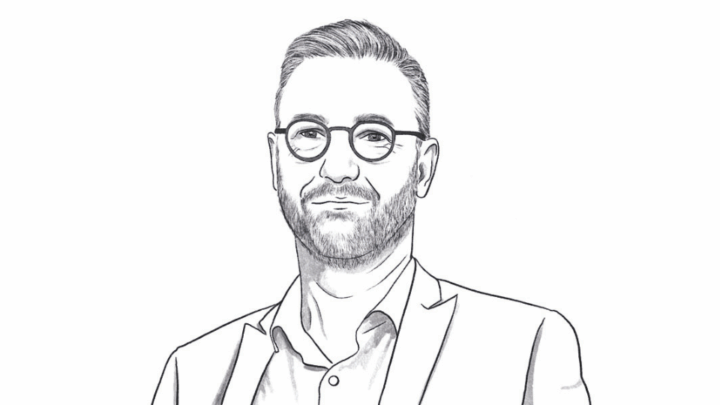
La récente polémique autour de Keytruda, médicament efficace contre certains cancers mais jugé « trop cher » par l’UFC-Que Choisir, illustre une difficulté récurrente : le débat public sur le prix des traitements se limite trop souvent à leur coût immédiat, sans prendre en compte la réalité de leur développement. Derrière chaque médicament, il y a plus d’une décennie de recherche, des centaines de millions d’euros investis, et un cadre réglementaire parmi les plus stricts au monde.
Il est essentiel de rappeler que développer un médicament est un processus long, risqué et coûteux. Entre l’identification d’une molécule et sa mise à disposition des patients, il s’écoule en moyenne dix ans. Les essais cliniques mobilisent des milliers de patients, les protocoles sont encadrés par des normes de sécurité draconiennes et, au final, seul un projet sur dix aboutit à une autorisation de mise sur le marché. Les prix fixés ne rémunèrent donc pas seulement la réussite visible, mais aussi toutes les recherches qui n’ont pas abouti.
À cela s’ajoute le poids croissant des contraintes réglementaires européennes, qui allongent les délais de mise sur le marché et freinent l’agilité de nos industriels. Ce qui est conçu comme une garantie de sécurité se traduit parfois par une dépendance accrue aux importations, car d’autres régions du monde, moins contraintes, produisent et exportent plus rapidement. Résultat : l’Europe consomme mais innove moins, au risque de perdre en compétitivité et en souveraineté sanitaire.
Or, innover ne signifie pas seulement découvrir de nouvelles molécules. Cela suppose aussi de maîtriser des procédés différenciants : la lyophilisation pour garantir la stabilité des produits, les formes stériles multi-doses pour sécuriser les traitements, les biothérapies qui ouvrent des perspectives inédites contre les maladies chroniques ou rares. Ces technologies demandent des investissements massifs et des compétences rares. Si nous voulons que les patients européens bénéficient de traitements de pointe accessibles et adaptés, nous devons les soutenir.
L’enjeu est stratégique. Les crises récentes ont rappelé la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement. Trop souvent, la recherche est menée en Europe, mais la production s’effectue ailleurs. Recréer des synergies entre recherche, développement et production, sur un même territoire, c’est garantir un accès plus rapide aux traitements, renforcer la résilience de nos systèmes de santé et offrir aux talents européens un écosystème compétitif et attractif.
Le débat sur le prix des médicaments doit donc être replacé dans cette réalité. Oui, certains traitements coûtent cher, mais leur valeur ne peut être réduite à leur tarif. Ils incarnent des années d’efforts scientifiques, de prise de risques et d’investissements. Ils sauvent des vies, améliorent la qualité des soins et contribuent à la souveraineté sanitaire du continent.
Loin des caricatures, l’innovation pharmaceutique doit être comprise pour ce qu’elle est : un moteur de progrès médical mais aussi un pilier de compétitivité et de stabilité économique. À l’heure où l’Europe cherche à concilier souveraineté et croissance, il est urgent d’en faire une priorité collective.