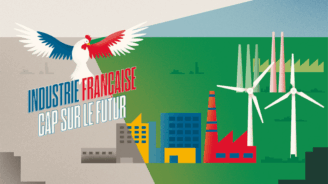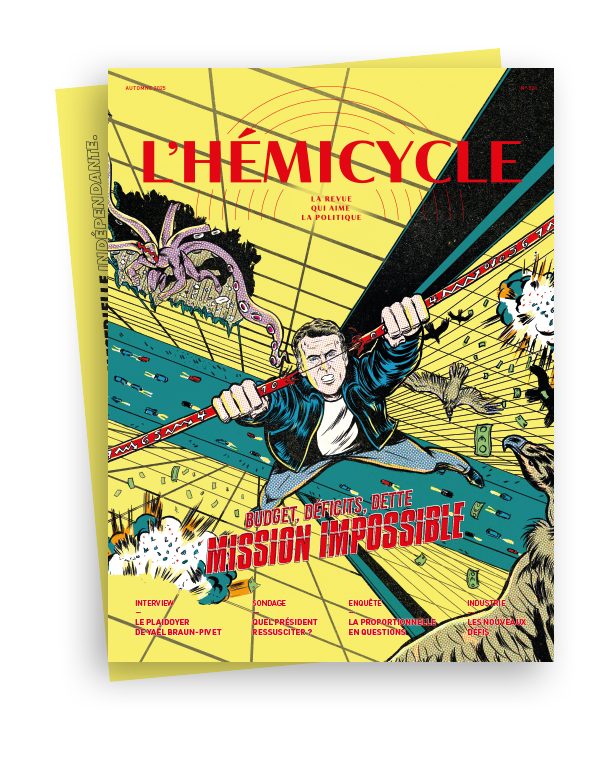Yves Laqueille, directeur général du Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne (GIM), revient sur les forces et les faiblesses de la France, mais également sur les erreurs stratégiques commises. Il souligne les leviers encore disponibles pour redonner à l’industrie une place centrale.
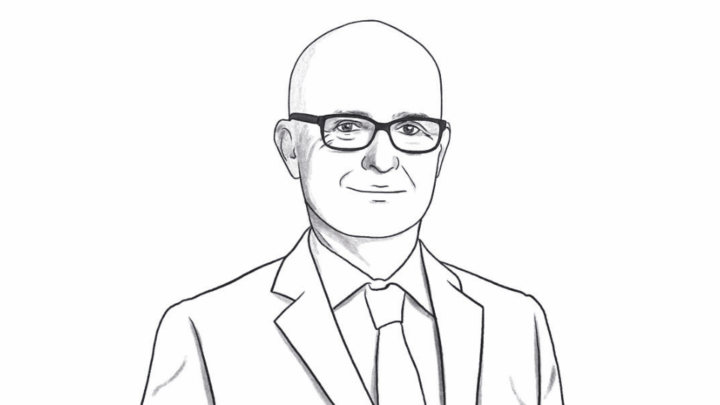
Illustration : Mariam Tagadirt
Notre pays a-t-il conscience de l’importance d’une industrie forte ?
Yves Laqueille Je ne suis pas sûr que le pays ait conscience des forces et des faiblesses de son industrie. Ne boudons pas notre plaisir : depuis dix ans, l’emploi s’est retourné et les investissements aussi. Mais au sein de notre organisation, nous nous mobilisons sur la promotion de l’industrie et de ses métiers, en pleine modernisation. Je finis par m’interroger sur ces actions : elles rassurent, mais ce faisant, elles démobilisent, et nos difficultés ne sont pas traitées. L’industrie est un pilier essentiel de notre souveraineté. Sans elle, nous nous en remettons aux autres pays, pour les ressources comme pour les productions : nous ne manquerons pas du seul germanium. Et comme elle s’inscrit dans le temps long, et avec une vision d’ensemble globale des projets, le contexte ambiant ne facilite pas cette démarche.
Le fait de miser sur la mondialisation était donc une erreur ?
Y.L. L’augmentation des échanges internationaux a permis de transférer des richesses et des emplois de façon plus équilibrée vers des pays plus pauvres. Mais pour autant, rêver d’une France sans usines ni productions ne pouvait qu’affecter notre souveraineté, nous faire décrocher dans de nombreuses technologies, et inciter d’autres pays à prendre un leadership. Un exemple avec le secteur automobile et la Chine : ne maîtrisant pas le moteur thermique, elle a laissé le champ libre aux constructeurs étrangers tout en investissant parallèlement dans la chaîne complète des technologies du véhicule électrique, avec le résultat que nous constatons aujourd’hui. Les réactions tardives et erratiques en Europe ont conduit naturellement à une situation inverse.
Un sursaut est-il possible ?
Y.L. Il ne faut pas se résigner mais se mobiliser. Commençons par prendre des décisions politiques qui ne mettent pas en difficulté nos fleurons. Car heureusement, il subsiste des secteurs forts, comme l’aéronautique ou le nucléaire qui redémarre. Implantations ou extensions, formation des jeunes, adaptation des compétences pour les moins jeunes, « assagissement » des cotisations et impôts, assainissement d’un imbroglio réglementaire et normatif tout aussi coûteux que chronophage, encouragement aux investissements… les sujets de progrès ne manquent pas. En Île-de-France par exemple, tant pour les implantations, le financement des investissements que pour la formation de salariés dont il faut parfaire les compétences, le compte n’y est pas. Et que dire aux startups industrielles, qui voient devant elles, au moment de passer à la phase industrialisation, ce qu’elles appellent la Vallée de la mort ? Il faut trouver des investisseurs patients et résilients, qui s’inscrivent dans un temps long, consommé à déployer leur activité mais gaspillé aussi par des tracasseries administratives. Que dire aux PMI qui attendent parfois trois ans pour percevoir leur crédit impôts recherche ? Et faut-il se féliciter qu’un grand industriel ait eu à pousser un coup de gueule pour voir tout d’un coup ses difficultés d’implantation se résoudre ?
Les jeunes se détournent des métiers de l’industrie. Ce désamour est-il définitif ?
Y.L. L’industrie continue à véhiculer une image négative de ses métiers dans l’inconscient collectif : cela impacte les jeunes. La fermeture passée de sites emblématiques a pu marquer leur environnement familial. Et pourtant, du bac pro à l’ingénieur, les salariés des entreprises industrielles considèrent en majorité qu’ils ont un métier et pas seulement un emploi, et se trouvent gratifiés par les réalisations concrètes issues de leur travail. Nous continuons d’œuvrer auprès de tous les prescripteurs, enseignants, parents, media, pour faire reconnaître la réalité des métiers. Mais attention : cela prend du temps que nous n’aurons bientôt plus.
C’est une question de souveraineté, mais également d’utilité sociale ?
Y.L. L’industrie reste le plus fort lieu de brassage social : ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres s’y côtoient au quotidien. Ce brassage favorise la cohésion, promeut l’ascenseur social et la promotion des talents, quel que soit le diplôme d’origine. Dans d’autres secteurs cette porosité est beaucoup moins marquée et parfois totalement absente. Dans une société aussi polarisée, ces exemples de cohésion et d’évolution méritent d’être soulignés.
Quels leviers faut-il activer pour favoriser notre secteur industriel ?
Y.L. Il faut mobiliser tous les leviers. J’ai récemment entendu cette phrase qui résume la situation : « La France a une industrie de la défense ; l’Allemagne défend son industrie ». Là-bas, quand une difficulté émerge, les acteurs économiques et sociaux se concertent et les réponses sont rapidement trouvées, dans le consensus : financement, fiscalité, réglementation, etc. En France, nous n’en sommes pas là, mais heureusement, des secteurs exemplaires, comme l’aéronautique et la défense, savent apporter des réponses et bénéficient d’une synergie privé/public qui fonctionne. Cette méthode est peut-être à cultiver et dupliquer dans toutes les activités où nous sommes encore performants. Par ailleurs, les sujets industriels sont, par nature, complexes. Les décisions politiques qui les concernent devraient être prises avec recul, dans un climat apaisé, en s’appuyant sur une véritable analyse bénéfice/risque, plutôt que sous l’effet de l’émotion ou de la doctrine. Ou alors, allons au bout de l’exercice, et imaginons un pays sans industrie…
Il n’est pas trop tard ?
Y.L. Je ne crois pas au rapatriement des activités envoyées dans les pays à bas coût. En revanche, il faut que nous conservions l’existant et que nous renforcions l’innovation afin de donner naissance à l’industrie de demain. Désormais, nos politiques françaises et européennes n’ont d’autres choix que de nous projeter dans des secteurs porteurs, à fort potentiel.
Quelles sont les bonnes raisons d’être optimiste ?
Y.L. Elles sont nombreuses, et je vous en propose une inattendue. La France a un atout unique au monde que pourtant certains ne nous envient pas : ce côté râleur qui permet quand il est un peu canalisé des remises en cause, et donc la créativité et l’innovation. A nous de cultiver et d’organiser un peu ce génie bien français !