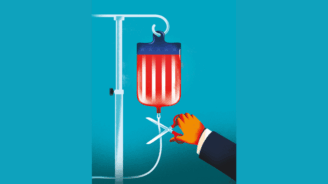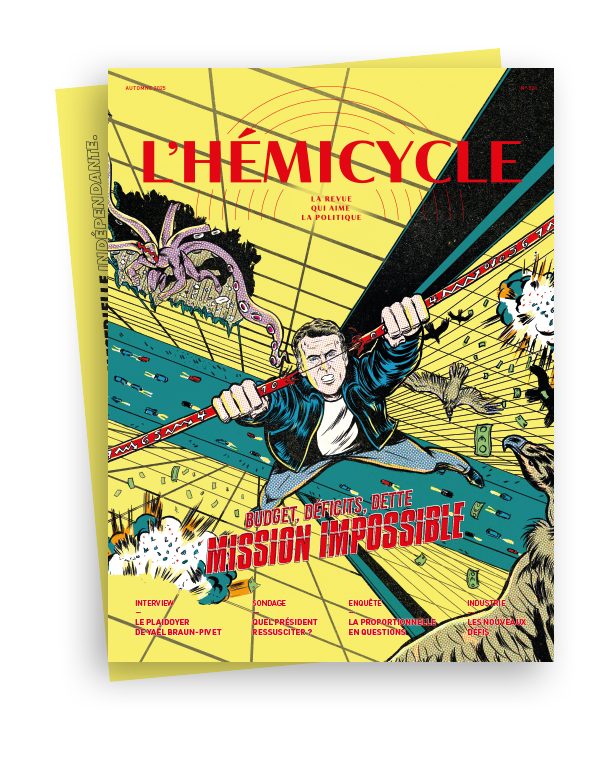Face à l’échec patent du tout-sécuritaire français, le mouvement citoyen Les Voies exige une rupture immédiate avec quarante ans de démagogie pénale. Leurs propositions tentent de redessiner les contours d’une justice plus humaine et plus efficace, selon sa présidente, Amandine Rogeon.

Photo : Freep!k
84 951 détenus pour 62 509 places : avec un taux d’occupation de 135,9 %, nos prisons sont à l’agonie. Et pourtant, les réponses spectaculaires des politiques s’accumulent – construction de nouvelles places, allongement des peines, multiplication des régimes d’isolement – sans parvenir à endiguer la délinquance. Résultat : 4 800 prisonniers dorment à même le sol dans des conditions que la Cour européenne qualifie de “traitement inhumain et dégradant.”
Cette faillite morale masque un désastre économique et sécuritaire : deux ex-détenus sur trois récidivent dans les cinq ans, tandis que l’incarcération coûte 105 euros par jour et par détenu, contre 10 euros seulement pour une solution de surveillance électronique. « Cessons de croire que la sévérité se mesure au nombre de barreaux ou à la longueur des peines. La véritable fermeté repose sur le courage politique de mettre fin à un cycle qui échoue et à investir dans ce qui fonctionne pour protéger les citoyennes et les citoyens de notre pays », affirme Amandine Rogeon, présidente du mouvement Les Voies.
Quand nos voisins européens réhabilitent plutôt qu’ils n’enferment
Des solutions progressistes et efficaces existent pourtant. La Norvège affiche 20 % de récidive contre 60 % en France. En Suède, 75 % des peines s’exécutent en milieu ouvert avec un suivi personnalisé par les services de probation, divisant le taux de réitération par deux. Leur principe est clair : “La punition, c’est la privation de liberté. Les autres droits demeurent.”
En comparant les modèles européens au modèle français, le mouvement Les Voies propose un plan de sortie de crise : diviser par deux les peines fermes inférieures à deux ans et développer massivement les alternatives – travail d’intérêt général, semi-liberté, surveillance électronique. D’autres ruptures s’imposent : instaurer par exemple un numerus clausus carcéral pour interdire les incarcérations au-delà des capacités d’accueil, contraignant l’État à privilégier les aménagements de peine. Pour retrouver une justice au service du progrès et de la cohésion sociale, la généralisation de la justice restaurative doit en être l’émanation : rencontres détenus-victimes, médiations supervisées et processus de réparation.
Une volonté de progrès social
Cette transformation obligatoire ne relève pas du seul impératif budgétaire, mais bel et bien de la raison d’État. Pour une société démocratique restaurée, nous devons réinterroger notre rapport à la justice. Car la refonte du système pénal – une priorité absolue pour les Voies – conditionne la restauration de notre contrat social républicain.