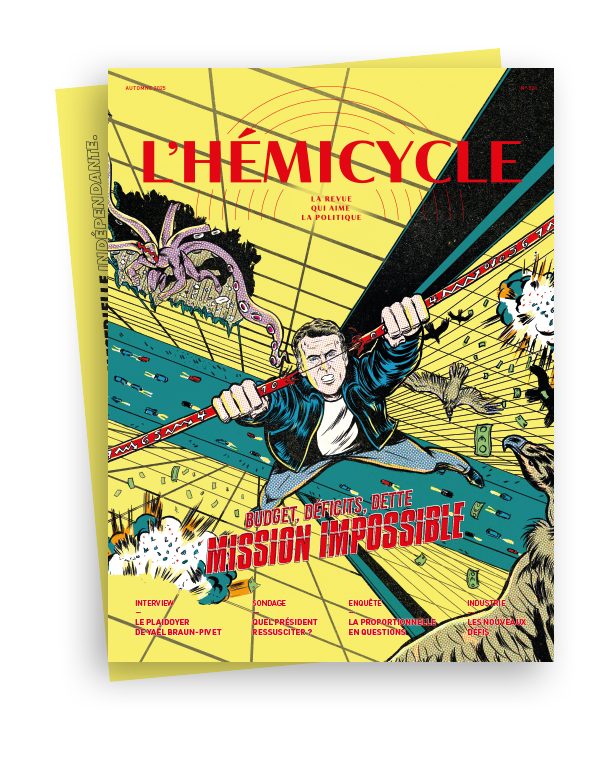Après des années de création nette d’usines, le mouvement de réindustrialisation marque le pas. Le ciel s’assombrit sur notre économie. Une réaction massive s’impose au niveau européen.
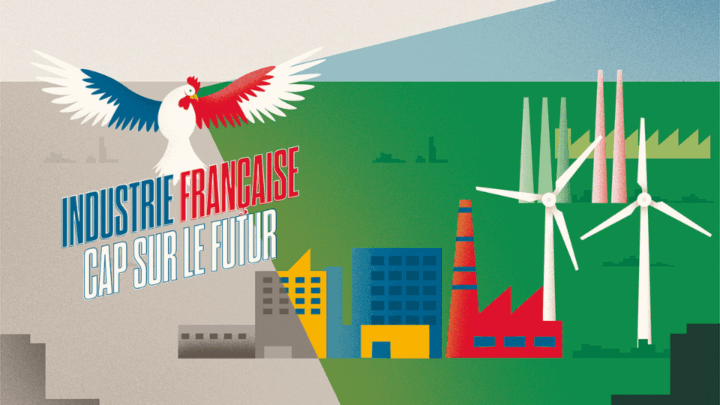
« Relocaliser nos industries et produire français est un beau slogan. Nous avons besoin de créer plus de richesses et d’investir ! ». Au cours de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) 2025, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a fait l’unanimité. Car le sujet de la désindustrialisation, et donc de notre souveraineté, ne laisse évidemment personne indifférent. Et pourtant, avec constance et aveuglement, nous avons depuis plusieurs décennies laissé partir à l’étranger nos capacités productives. Lors d’un colloque au Sénat, le 8 septembre dernier, le Président Gérard Larcher rappelait : « À l’heure où les règles du commerce international sont malmenées, il est essentiel de pouvoir compter sur nous-mêmes. »
Les chiffres sont éloquents : la part de l’industrie dans notre PIB est passée, entre 1995 et 2024, de 17 % à 10 %. Elle est aujourd’hui l’une des plus faibles en Europe. Une source de stress pour nos compatriotes : 86 % des Français estiment que l’industrie nationale est menacée et 62 % la jugent trop faible pour faire face aux chocs1. Pendant longtemps, nous avons voulu remplacer nos anciennes industries au profit d’une économie de services. « Dans les années 1970, nous avons fait le choix de nous insérer dans le commerce mondial en délocalisant une partie de notre production pour accéder à des approvisionnements à bas coût. Depuis 2008-2009, le constat est clair : on a trop désindustrialisé », analyse Olivier Lluansi, professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
Le digital, une priorité
La dépendance étrangère nous a littéralement explosé au visage lors de la crise sanitaire. D’où l’ambition actuelle de relocaliser nos chaînes de production critiques, sans pour autant reconstruire les usines d’hier, mais en imaginant une industrie propre, innovante et créatrice de valeur avec des emplois qualifiés. « Ici, une usine est deux fois et demie moins automatisée qu’en Chine et cinq fois moins qu’en Corée du Sud. On utilise donc moins de robots et, du coup, on récupère moins de datas. Moderniser à travers le digital est une priorité », déplorait Laurent Bataille, président de Schneider Electric, lors de la REF 2025.
La France était pourtant sur une tendance positive de création nette d’usines depuis quelques années, mais le mouvement est en train de se retourner. « À nous d’identifier les filières sur lesquelles investir », estime Patrick Martin, président du Medef. Pour ce faire, un cap et une stratégie claire sont essentielles, selon Anaïs Voy-Gillis, chercheuse associée à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Poitiers : « La tentative de réindustrialisation s’essouffle, car on ne se pose pas les questions essentielles : « pourquoi » ? « Quel est le projet de société et quel cadre légal est nécessaire ? » Il faut, soit changer nos règles internes pour être compétitifs face aux autres pays ; soit faire évoluer les règles du commerce international. Il faut arrêter les doubles normes qui réduisent à néant nos efforts ».
Urgence absolue
Sur le plan réglementaire, une action européenne pourrait être menée, d’après Arnaud de Morgny, directeur adjoint du Centre de Recherche appliquée de l’Ecole de Guerre Économique (EGE) : « Le gouvernement doit agir pour appliquer les mêmes obligations aux sociétés étrangères. Il faut rééquilibrer la manière dont s’opère la compétition sur notre planète. Et sur le plan interne, redorer le blason du secteur industriel auprès des Français et notamment des enseignants. » Et d’ajouter : « La situation est tragique ! Un pays de consommateurs, sans pouvoir d’achat, n’a aucun avenir. Or, d’où vient la richesse ? De la production ! ».
Face à cette « cécité stratégique », l’EGE a développé un indice de risque de désindustrialisation. Une approche qui vise à identifier les entreprises à risque « avant qu’il ne soit trop tard et à permettre une mobilisation coordonnée des acteurs concernés (État, collectivités, syndicats, investisseurs, experts, citoyens engagés) ». Il en ressort que, parmi les grandes entreprises étudiées, l’indice de risque est parfois élevé.
Dans ce contexte d’urgence absolue, les contraintes liées à la transition sont mal comprises par les Français : 67 % d’entre eux estiment que les normes environnementales fragilisent la compétitivité, et 71 % estiment que les positions écologistes relèvent davantage de l’idéologie que de la science. Ils attendent une politique industrielle ambitieuse et réellement compatible avec nos engagements. Anaïs Voy-Gillis affirme qu’il serait aussi temps « de jouer collectif, avec la commande publique, mais également entre entreprises privées, qui doivent parfois accepter de payer plus cher certains produits locaux ».
Écologie positive
La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) pointe, de son côté, une certaine idéologie dominante2, alors que les Français attendraient plutôt une écologie plus positive. « On reproche la même chose qu’à l’État, c’est-à-dire un excès de normes et de règlements qui finit par empiéter sur les libertés de chacun : une forme dirigiste et descendante, renforcée par une vision fiscaliste avec plus d’impôts. Il y a un besoin d’écologie politique, mais pas d’écologisme plutôt anti-marché, anti-profit ou anti-croissance », affirme Dominique Reynié, directeur général de la Fondapol. Il nous faut des textes compatibles avec la vie de chacun, la croissance et même la prospérité pour financer notre modèle de société. »
Un diagnostic que nuance Nathalie Vallier, du cabinet Eurocif : « Plus que la relance de la croissance, la réindustrialisation doit être avant tout un moteur de refondation de la création de valeur, dans le cadre d’un projet économique soutenable ». Signe des temps, l’accord entre Mistral AI et le hollandais ASML indique une volonté de bâtir une alternative crédible face aux géants américains et chinois de l’IA. Espérons qu’il s’agira d’une étape clé vers une souveraineté numérique européenne qui devrait ruisseler sur d’autres secteurs.