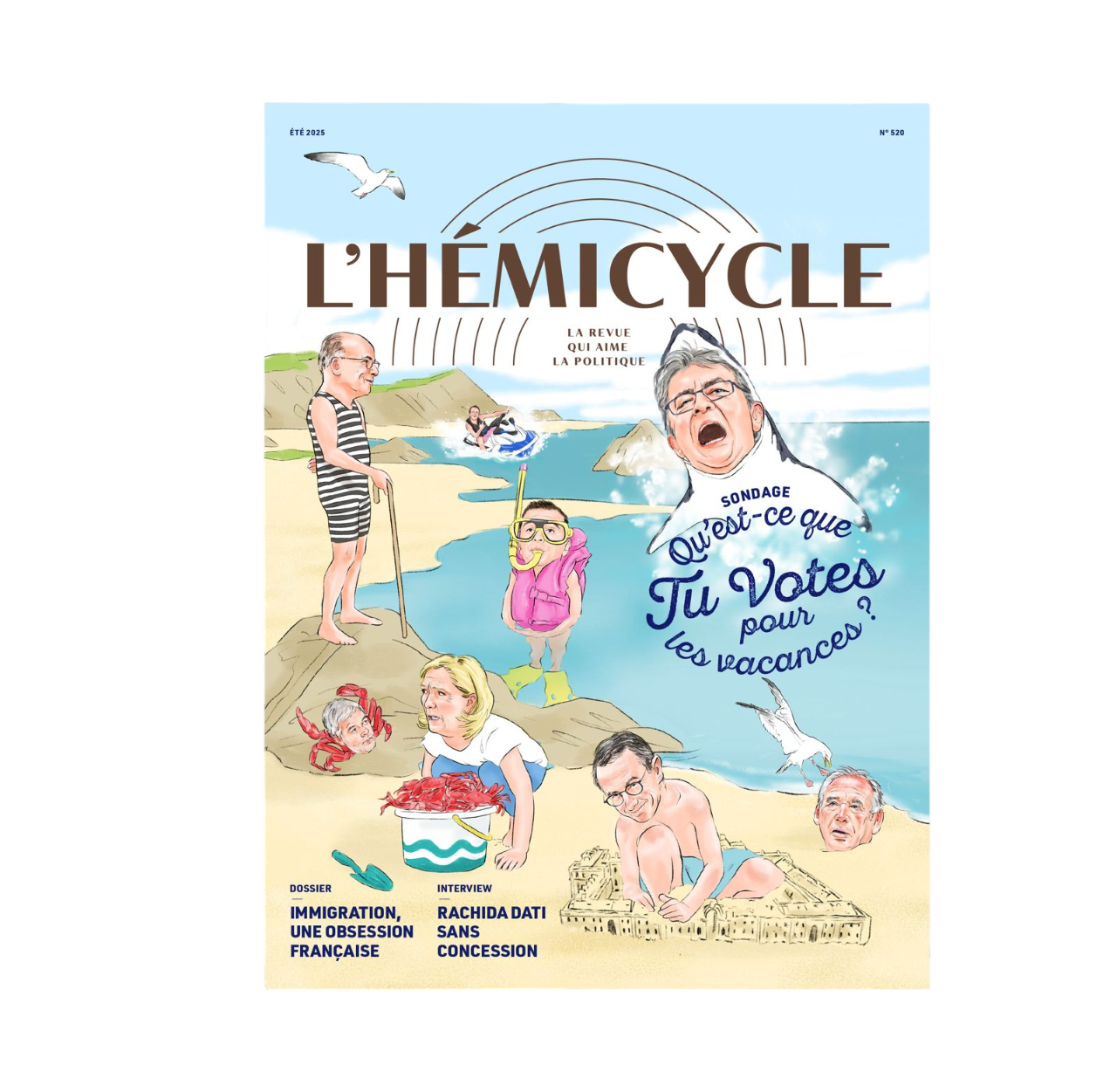Le regain industriel amorcé ces dernières années semble s’être quelques peu enrayé. Une dynamique à surveiller, alors que la filière s’impose comme un enjeu prioritaire pour répondre aux grandes transitions. Repères.

Illustration : D.A
La pandémie de 2020 eut au une affaire de souveraineté. Sinon d’indépendance. La Covid saluait ainsi, à sa manière, la dynamique enclenchée depuis 2017, marquée par un fort niveau de création d’emplois dans l’industrie. La période à venir s’annonçait pleine de promesses, enregistrant un solde positif d’ouvertures d’usine auquel la France n’était plus habituée, comme un regain d’attractivité auprès des investisseurs. La marche de la réindustrialisation s’avérait « haute, mais atteignable », estimait encore Bpifrance en avril dernier, fixant l’objectif de 12 % de part d’industrie manufacturière dans le PIB français en 2030 (contre 9,7 % aujourd’hui) et la création de 600 000 emplois.
Coup de froid
Mais depuis ce même mois d’avril, la réindustrialisation marque le pas. Au premier semestre 2024, le cabinet Trendeo relève une baisse des ouvertures d’usine dans le pays (- 4 %) et une augmentation des fermetures (+ 9 %) par rapport à une année 2023 déjà marquée par un ralentissement. Avec 18 ouvertures de plus que de fermetures, le solde demeure certes positif, mais 30 % en deçà de celui du premier semestre 2023. Et le nombre d’emplois industriels créés fléchit (- 44 % sur la période).
Les indicateurs de l’Insee observent ce même mouvement, par le prisme de la production française. Celle-ci enregistre ainsi une baisse de 3 % en un an, touchant une multitude de filières : biens d’équipement (- 6,8 %), matériel de transport (- 7,1 %) et plus encore automobile (- 17,8 %). « Réindustrialiser ne se fait pas en appuyant sur un bouton, convient Romain Soubeyran, directeur général de Centrale Supélec, la grande école de l’industrie. On ne peut pas arrêter le nucléaire pendant 20 ans et se montrer scandalisé par les difficultés à relancer la machine. C’est un travail positif, mais colossal ! »
Chèques VS Commandes
Parmi les leviers à actionner, l’un des principaux devrait s’appeler « commande publique », estime Claude Revel, ancienne Déléguée interministérielle à l’intelligence économique et directrice du think tank Skema Publika. « Aux États-Unis, les Gafam ont été biberonnées à la commande publique, sans quoi aucune d’entre elles n’aurait pu se développer. Dès le début et aujourd’hui encore, toutes les agences américaines passent des contrats avec leurs industriels, sans que cela ne dérange personne », relève-t-elle.
De son côté, l’approche française penche plutôt pour une multiplication des aides. « Celles-ci peuvent être utiles, mais il y a une centaine d’aides proposées, parfois redondantes, non coordonnées et d’une grande complexité », estime Claude Revel. Créant même des effets d’aubaine qui s’avèrent contre productifs. « De grandes entreprises utilisent l’argent public pour des projets qu’elles comptaient mener de toute façon. Ou en profitent via de petites structures qui, par ailleurs, leur appartiennent. Quand ce ne sont pas des entreprises étrangères qui décrochent des CIR (crédit impôt recherche) pour faire de la R&D en France, puis produire chez elles. » Autant de situations qui faussent le fléchage de l’effort public vers sa cible prioritaire, le tissu de PMI et ETI, attendues comme le moteur de la réindustrialisation.
Le Code de la commande publique donne des possibilités aux administrations de recourir à l’industrie locale, sans que cela soit toujours bien connu. « Les fonctionnaires et leur direction ont parfois peur d’être accusés de favoritisme dans leurs commandes, alors que de nombreux projets leur donneraient le droit de privilégier nos acteurs. Il y a un enjeu de partage d’informations à ce sujet. » L’Europe, malgré sa philosophie de libre-concurrence, offre, elle aussi, des espaces pour le faire : « Au cours des JO de Londres, 94 % des contrats avaient été noués avec des entreprises britanniques, en toute légalité », souligne Claude Revel. Rappelant qu’à l’époque, en 2012, le Royaume-Uni était encore soumis aux mêmes règles communautaires que nous.
Le défi jeune
Des freins d’ordre culturel restent à lever. « Notre aversion au risque nous amène à financer 10 entreprises à faible rentabilité, plutôt que 10 dont 9 qui échoueront et un Google. En conséquence, nous n’avons pas de Google », schématise Romain Soubeyran.
Le directeur de Centrale Supélec constate également les traces que quarante ans de désindustrialisation ont laissées dans le rapport des Français à la technique et à la science. « Les formations technologiques ou professionnelles dans le secteur de la production ont perdu près de 150 000 élèves entre 1995 et 2020, soit une baisse de 26 % », confirme l’IGÉSR dans son rapport(1). Lequel identifie un fort enjeu d’orientation professionnelle. En effet, parmi les élèves formés à ces métiers, seul un sur 2 occupera finalement un emploi industriel(2).
À plus haut niveau, la France est reconnue pour l’excellence de sa formation des ingénieurs, mais environ 10 000 diplômés par an manquent à l’appel. « Nous devons aller chercher les élèves de milieux défavorisés et les jeunes femmes, qui se détournent des filières scientifiques et dont le talent nous échappe trop largement, ainsi que les étudiants internationaux », décrypte Romain Soubeyran. Chez ces derniers, l’attractivité viendra aussi du cercle vertueux enclenché par la réindustrialisation. « Plus notre territoire abritera de projets industriels et d’innovations, plus ils seront tentés par la France pour étudier, travailler et entreprendre », prédit-il.