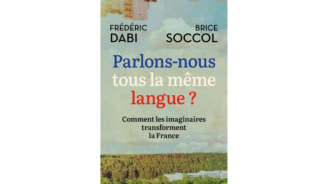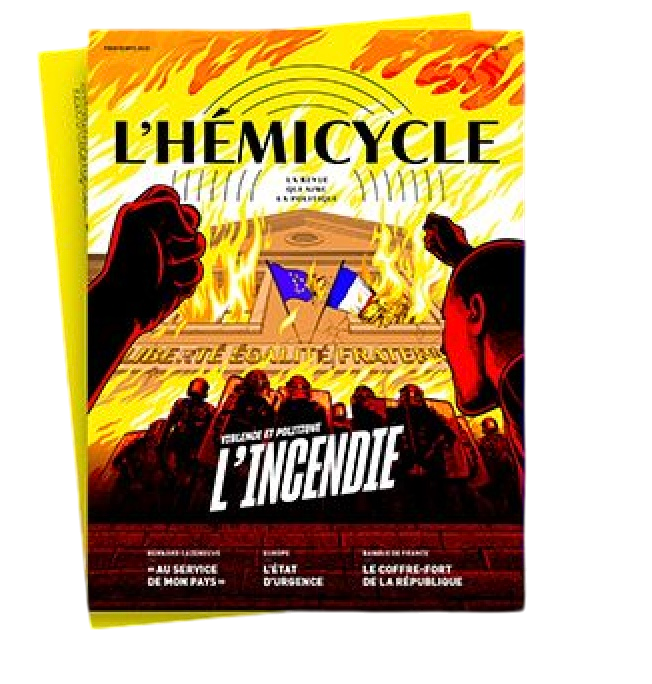À l’occasion de la visite d’État du président Emmanuel Macron en Indonésie, la célèbre chanteuse et actrice franco-indonésienne Anggun nous a accordé un entretien exclusif. Figure iconique de la scène musicale internationale, elle incarne, avec sensibilité et conviction, le lien vivant entre deux cultures que tout semble opposer et que beaucoup découvrent encore. Elle revient ici sur la place de la culture dans les relations bilatérales, sur le regard que portent les deux sociétés l’une sur l’autre, et sur les synergies possibles entre artistes, institutions et citoyens. Un témoignage à lire comme une invitation à penser la diplomatie autrement…

Vous êtes à la fois une figure iconique de la scène musicale internationale et un véritable pont entre la France et l’Indonésie. Que représente pour vous cette double appartenance ?
Anggun : Comme je le dis souvent, je me sens génétiquement modifiée ! Une journaliste internationale m’avait dit une fois « je vous vois comme le chaînon manquant entre l’Est et l’Ouest ». J’avais trouvé cette phrase pertinente car oui je suis le fruit de cette double culture. J’ai quitté mon Indonésie natale à l’âge de 20 ans en parlant trois mots de français approximatif. Maintenant, je suis trilingue, même si à mon grand désarroi je fais encore des fautes car la langue française est certes magnifique mais tellement complexe et faite de tellement d’exceptions … Je me sens chanceuse d’avoir été « adoptée » par la France et les Français. C’est un pays que j’aime, même pour ses défauts ! Et c’est devenu ma maison de vie et de cœur.
Ressentez-vous, à titre personnel, une évolution du regard porté par les Indonésiens sur la culture française – et inversement ?
Anggun : L’Indonésie est sans doute un géant méconnu des Occidentaux et des Français. Les Indonésiens sont de nature discrète, et toutes les strates de la société, de la pensée, et des comportements sont empreints de cette discrétion. Ce n’est pas un pays bruyant. Mais le pays s’est transformé de manière impressionnante depuis plus de deux décennies et est devenu une puissance économique, il a le potentiel pour devenir un acteur culturel aussi important que la Corée du Sud. L’Indonésie a une production culturelle locale très dynamique – cinéma, musique, arts graphiques, …- qui commence à s’exporter. Pendant longtemps, j’étais littéralement la seule Indonésienne connue en Europe, au Canada, etc. De nos jours, des artistes émergents commencent enfin à se faire connaître et je vous avoue que j’en suis soulagée car j’aime être appelée une « pionnière » mais j’étais attristée d’être vue comme « la seule » pendant trop longtemps. Quant à l’image de la France en Indonésie, elle est vue comme une grande puissance. Comme une sorte de musée de l’élégance, du raffinement et du bien-vivre, comme dans une carte postale de « Emily in Paris ». Mais il y a certaines incompréhensions comme le concept de laïcité, qui n’existe pas en Indonésie, et qui est souvent caricaturé. En ce qui me concerne, je trouve pourtant, en tant que Française d’adoption, que la laïcité est l’une des plus belles choses que la France a su faire germer.
À l’heure où les relations économiques et stratégiques entre la France et l’Indonésie se renforcent, pensez-vous que la culture bénéficie (ou devrait bénéficier) de la même attention politique ?
Anggun : La culture est souvent labellisée comme un « soft power ». Je pense au contraire que c’est un « hard power », que c’est un vrai enjeu, certainement pas un sujet secondaire. Je parlais de la Corée du Sud, mais la Turquie en a fait une vraie industrie du fait de ses productions de fiction qui cartonnent dans de nombreux pays. Et si Trump a mis en émoi l’industrie de la production audiovisuelle aux USA avec son projet de taxation des productions réalisées à l’étranger, c’est qu’il y a bien un enjeu économique derrière l’enjeu culturel. La culture et l’influence culturelle, ce sont des pouvoirs. De très grands pouvoirs même.
Quelles collaborations culturelles vous paraissent (ou paraîtraient) emblématiques ou prometteuses entre les deux pays ?
Anggun : Un point commun entre les deux pays est le champ large des productions culturelles. L’industrie cinématographique indonésienne est en pleine croissance. J’ai d’ailleurs eu la chance de tourner dans le film de Wregas Bhanuteja, star de la « nouvelle vague » indonésienne dans le film « Para Perasuk » (Les Intrus) qui sortira en fin d’année. Les échanges culturels dans ce domaine peuvent être puissants, l’Indonésie pouvant s’inspirer des politiques de soutien à la production mises en place par la France. La musique bien évidemment est un champ des possibles. Et la France, avec sa grande expérience dans l’économie des musées avec des marques fortes qui s’exportent, notamment au Moyen-Orient, peut sûrement trouver des synergies avec une demande forte dans ce domaine en Indonésie.
Le président Prabowo place l’éducation et la nutrition infantile au cœur de sa vision politique. Comment la culture peut-elle accompagner cette transformation sociale ?
Anggun : Le président Prabowo a fait de la malnutrition un combat prioritaire et il a raison, je le soutiens avec force. Je suis particulièrement sensibilisée sur ce dossier car j’ai été pendant plusieurs années Ambassadrice de Bonne Volonté pour la FAO/ONU sur les questions d’insécurité alimentaire. Un grand pays comme l’Indonésie qui a une autosuffisance de plus de 90% sur la production de riz ne peut plus se permettre de voir près de 2 millions d’enfants en insécurité alimentaire. L’intelligence du Président Prabowo est de lier ce combat du déficit calorique journalier de certains enfants à l’environnement éducatif qui peut apporter en termes de logistique, d’organisation, et de structure une réponse efficace car il y a une scolarisation obligatoire de 6 ans dans le primaire puis 6 ans dans le secondaire. Le monde de la culture a un rôle à jouer pour mettre en lumière des problèmes structurels et aider à y apporter des solutions collectives. C’est ce que je faisais à l’époque avec la FAO en « médiatisant » des causes qui n’étaient pas suffisamment prises à bras le corps par les gouvernements. Je suis ravie – en tant que maman notamment – que l’Indonésie ait un plan ambitieux et volontariste à ce sujet.
Vous avez souvent travaillé avec des jeunes artistes ou des programmes éducatifs. Avez-vous des exemples de projets menés ou souhaités en Indonésie ou en France dans ce domaine ?
Anggun : La célébrité ne sert à rien à part flatter un ego que je n’ai pas. L’utilité d’un artiste c’est de se faire le porte-voix de messages que l’on entendrait pas ou peu sans cela. Lors du terrible tsunami qui a touché l’Asie du Sud-Est dont l’Indonésie, il y a 20 ans, je me suis mobilisée avec plein d’organisations de jeunesse sur la replantation de la mangrove, la forêt humide en bord des côtes, véritable « absorbant naturel », qui aurait pu amoindrir les conséquences du désastre si celle-ci avait été protégée et non détruite par les activités humaines. Je suis allée planter une zone de mangrove avec plein de jeunes, conscients de l’enjeu climatique et environnemental. Une expérience qui m’a marquée.
Dans un monde multipolaire, quelle place pour le « soft power » culturel (qui, comme vous le disiez, est un « hard power »), notamment celui porté par des artistes franco-asiatiques comme vous ?
Anggun : Je pense en effet que la culture est un pouvoir. Pas un pouvoir mou ou secondaire mais un vrai pouvoir. Mais je ne me vois pas comme une ambassadrice, ou comme un agent, mais comme un lien, un liant, un facilitateur. Si ma double culture, mon histoire partagée entre l’Indonésie et la France, peuvent être utiles à l’émergence d’accords, de partenariats, d’un renforcement culturel entre les deux pays, je serai ravie. D’où ma présence lors de cette visite présidentielle.
Pensez-vous que la culture puisse être un levier de diplomatie efficace, à l’instar de certains accords économiques ou militaires ?
Anggun : La culture est une économie. Il y a les créateurs et les producteurs qui les financent, distribuent et « marketent » leurs œuvres. Dans une économie mondialisée et digitalisée, une œuvre indonésienne a la capacité de rencontrer une audience française, et une œuvre française a la capacité de rencontrer un public indonésien. J’ai bien réussi à séduire le public français à titre personnel… Tout ce qui permet aux acteurs économiques de la culture de favoriser l’émergence de productions françaises en Indonésie et indonésiennes en France est à saluer. J’espère que cette visite va permettre aux deux pays de considérer leur attractivité culturelle respective sous un nouveau jour.
Travaillez-vous actuellement sur des projets impliquant les deux pays ? Envisagez-vous de lancer une initiative à l’occasion de ce rapprochement franco-indonésien ?
Anggun : J’ai participé il y a quelques années avec l’Ambassade d’Indonésie à Paris à la promotion de jeunes artisans indonésiens de la mode à trouver une ouverture pour leurs créations. Leurs collections étaient présentées et vendues au BHV à Paris et cela avait rencontré un vif succès. J’adorerais renouveler l’expérience dans l’autre sens : aider de jeunes créateurs français dans la mode à trouver des opportunités d’exposition et de distribution en Indonésie.
Si vous pouviez faire une seule proposition concrète à Emmanuel Macron et PrabowoSubianto pour renforcer les liens culturels entre la France et l’Indonésie, quelle serait-elle ?
Anggun : Je ne sais pas si j’ai l’autorité de proposer quoi que ce soit, mais ça serait formidable de proposer une année culturelle conjointe entre les deux pays. La France et l’Indonésie pourraient organiser expositions, spectacles, ou débats autour d’une programmation riche et engagée qui mettrait en lumière la vitalité de la création contemporaine française en Indonésie et indonésienne en France. Allez, chiche, une année conjointe franco-indonésienne pour 2027 !
Quel message aimeriez-vous transmettre aux lecteurs français et indonésiens (cible : leaders d’opinion politiques et économiques), à ce moment-clé de l’histoire entre les deux nations ?
Anggun : L’Indonésie est un pays d’opportunités. C’est un pays complexe, traversé par de nombreuses contradictions comme dans toutes les sociétés du monde. Mais s’il y a quelque chose que je trouve formidable en Indonésie, et qui manque parfois cruellement à la France, c’est l’enthousiasme. Les Indonésiens sont très enthousiastes. Il y a une énergie communicative qui traverse la société. Les idées sont très vite mises en place. Les projets fleurissent rapidement. La France quant à elle a une culture de l’ingénierie et de la planification. Alliez les deux et vous ne pouvez que créer du bon !
Et si vous deviez chanter un seul titre pour résumer ce lien culturel unique… lequel choisiriez-vous ?
Anggun : La chanson « Une île » de Serge Lama est une merveille de poésie. C’est pour moi l’essence même de la touche française : des textes sublimes et ciselés, qui de surcroît ne sont pas élitistes mais populaires au sens noble du terme. La langue française c’est la langue des nuances et des métaphores. C’est une langue tellement poétique et belle. Je suis une vraie amoureuse de la langue française. « Une île, entre le ciel et l’eau… Ce serait là, face à la mer immense, là, sans espoir d’espérance. Tout seul face à ma destinée, plus seul qu’au cœur d’une forêt. Ce serait là, dans ma propre défaite, tout seul sans espoir de conquête, que je saurai enfin pourquoi, je t’ai quittée, moi qui n’aime que toi… Une île ». C’est ma vie : celle de l’éloignement, de l’absence, loin de mon île natale, Java. Ces paroles si françaises résonnent en moi comme le fil rouge de ma vie.