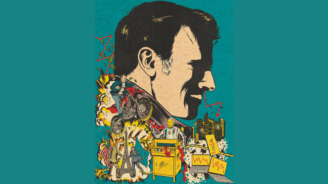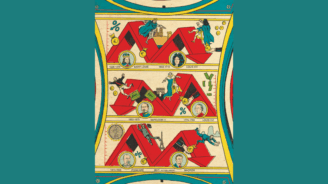Les décideurs et les pouvoirs publics devraient s’intéresser davantage à ceux, issus de la diversité, qui sont diplômés et qualifiés, explique le président de la Fondation Mozaïk et initiateur du sommet de l’inclusion économique le 29 novembre à Bercy.

photo : Samantha Hodeir
Vous organisez le premier sommet de l’inclusion économique, le 29 novembre, au ministère de l’Économie, en présence de Bruno Le Maire. Qu’en attendez-vous ?
Saïd Hammouche La croissance de demain ne peut pas se faire avec une partie de la population française, issue des banlieues populaires ou d’origine sociale et culturelle différente, restant en marge de la société. Celle-ci représente des forces vives dont une grande partie, contrairement aux idées reçues, a envie de réussir. Il y a urgence à s’intéresser à ceux qui sont disponibles, qualifiés et diplômés, mais qui ne trouvent ni emploi ni responsabilités dans les organisations. C’est un enjeu de justice sociale. J’ai fondé le cabinet de recrutement Mozaïk RH parce que j’entendais les dirigeants d’entreprise prétendre qu’il n’y avait pas de talents ni de personnes compétentes en banlieue. Nous avons contribué à placer plus de 10 000 personnes. La mobilisation des entreprises et des pouvoirs publics doit désormais s’amplifier. Le 29 novembre, c’est l’occasion de donner un coup d’accélérateur pour prendre le sujet à bras-le-corps afin d’avoir une société non pas qui exclut mais qui inclut.
Autrefois, on parlait de discrimination positive, aujourd’hui d’inclusion économique…
S. D. Ce n’est pas une évolution sémantique ou philosophique. Il ne s’agit pas de mettre des quotas de Noirs et d’Arabes pour garantir davantage de diversité. Nous avons toujours considéré que l’approche ethnique n’était pas la bonne. Notre politique de l’emploi reste sur une vision datant des années 1970 qui cible les publics les plus en difficulté, les personnes handicapées ou les chômeurs de longue durée. Il est, bien sûr, fondamental de s’occuper de ces publics. Mais on n’apporte pas de réponses concrètes à ceux qui sont qualifiés, en croyant qu’ils vont trouver par eux-mêmes un emploi. Or, quand on habite un quartier dit « sensible », on n’a pas de réseau. Des jeunes ont cru en la méritocratie en faisant des études supérieures, et ils se retrouvent inscrits durablement à Pôle emploi. Ce n’est ni normal, ni juste.
A quels freins auxquels se heurtent-ils ?
S. D. Quand on parle du chômage des jeunes de banlieue, on renvoie souvent la responsabilité sur ceux-ci en expliquant qu’ils n’ont pas envie de travailler. Près de 90% des recruteurs ne sont pas formés au recrutement inclusif. Forcément, ils ont des biais. On préfère celui que l’on connaît, dans son réseau, sa catégorie sociale ou son école, à celui qui a suivi un autre parcours. Résultat, les organisations recrutent des clones. Il faut donc agir sur les deux cibles. Les recruteurs, d’abord, afin de leur faire prendre conscience qu’il existe un autre vivier de talents. Pour des postes d’exécution, on n’a pas nécessairement besoin de diplômés des meilleures écoles de commerce. Les jeunes, ensuite, pour leur apprendre les attendus des processus de recrutement sur les métiers de demain.
De nombreux dispositifs pour lutter contre les discriminations à l’embauche ont déjà été lancés. Ont-ils fonctionné ?Oui, la plupart d’entre eux. Mais quel est leur impact ? Il ne suffit pas d’embaucher une poignée de jeunes pour que les choses changent. L’enjeu, désormais, est de faire système, et de modifier en profondeur le processus de recrutement ou bien d’avoir une action tellement forte que le système puisse lui-même intégrer naturellement toutes ces compétences. Nous devons identifier les entreprises qui sont capables de raconter ce qu’elles ont fait en matière de diversité et d’inclusion. Elles ne sont pas majoritaires, mais il y en a de plus en plus.